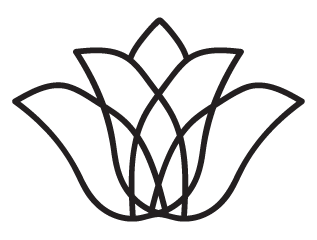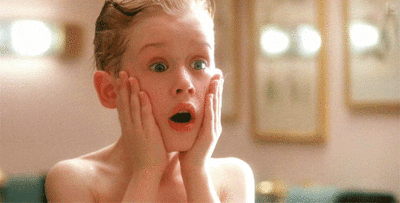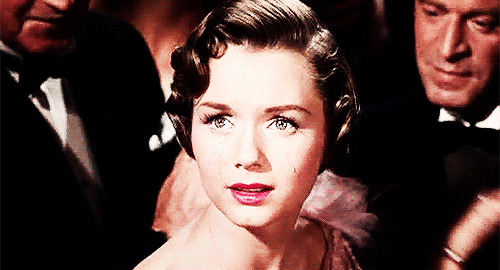10 juin 2019

– À quoi tu penses Jimmy ?
– Je traverse la rue qui me conduit à l’école et Maman me tient fermement le bras pour ne pas que je dévie de ma trajectoire. C’est dur pour moi ! J’ai peur d’y aller. Chaque matin j’ai la gorge serrée et j’arrive à peine à avaler les céréales qui flottent à la surface du bol. Et puis, quand je suis dehors, je regarde les arbres, les nouvelles couleurs des feuilles, je sens le vent sur mon visage, parfois la poussière rentre dans mes yeux et je me mets à hurler parce que ça brûle, ça fait pleurer, ça ne devrait pas rentrer comme ça dans mon corps…
Maman ne comprend pas, elle essaie de hurler plus fort que moi pour me faire taire, elle regarde les enfants au loin, elle m’attrape par la nuque, elle me tient fort pour que je cesse de bouger. Et moi j’ai encore plus peur, je me débats, je voudrais m’enfuir loin d’ici. Elle approche la tête de la mienne et crie dans mes oreilles : « Pourquoi tu ne veux pas aller à l’école ? Pourquoi ? Pourquoi ? ».
C’est comme ça tout le temps… Je crois qu’elle ne m’aime pas, je crois qu’elle a peur de moi. Mais c’est moi qui suis le plus terrifié. Je ne parle jamais, je n’y arrive pas, je ne sais pas comment dire ce que j’ai dans la tête. Parfois, j’ai l’impression qu’il y a plein de gros bleus dans mon corps, invisibles, gonflés et ça m’étouffe. J’ai mal de l’intérieur et il n’y a pas de mots pour ça. D’ailleurs, personne ne me demande si j’ai mal, on croit que je ne ressens rien, que je ne vois rien, que je ne dis rien.

– À quoi tu penses Lucie ?
– Je ne pense pas, je ne pense plus, vous savez. Je me réveille et je fais toujours les mêmes choses, parce que si je fais quelque chose de nouveau, je me sens oppressée, comme s’il manquait de l’air à mes poumons. J’ai l’impression que je vais disparaître dans l’imprévu, je me noie dans la nouveauté, je préfère retourner me coucher en attendant une autre journée.
Je me pèse le matin dès que je me réveille, toujours la même heure. J’ai aussi un ruban pour mesurer mon tour de taille, mes cuisses, ma poitrine… Au cas où, vous savez, au cas où j’aurais pris quelques grammes. Puis, je mange, enfin ce que je peux manger et ce qui ne me fera pas grossir. Parfois, je vomis. La première fois, c’était horrible, mais j’y suis habituée maintenant. Je sais que ça peut paraître bizarre, ça me soulage, sinon je me sens contaminée, grosse, repoussante.
Quand je marche dans la rue, je baisse les yeux, je ne supporte pas qu’on me regarde. J’ai peur de tout, de la vie, des autres, de moi. Alors pour moi, si je contrôle mon corps, ce que je mange, ce que je fais, je garde la tête hors de l’eau, je ne me noie pas encore.
Maman est partie avec un autre homme quand j’étais petite. J’ai toujours pensé que c’était peut-être parce que je n’étais pas assez jolie, je pleurais trop, ça la fatiguait. Il fallait toujours me forcer à manger, j’étais distraite et capricieuse. Je sais que c’est idiot, voyez-vous, il m’arrive de penser que si je garde un corps parfait, elle finira par revenir. C’est bête, je le sais bien.
Vous croyez que j’ai peur d’être à nouveau abandonnée ? Oui, je suis terrorisée, j’ai peur, ça me gangrène. J’attends quelqu’un qui ne reviendra pas et je n’arrive pas à me raisonner.

– À quoi tu penses Lizzie ?
– Je pense à lui, tout le temps, tout le temps. Je rêve qu’il va revenir et tout me prendre. Il m’a tout pris, vous savez ? Tout. Ma dignité, mon argent, mon libre arbitre, mes valeurs, ma lucidité. Je suis partie dans un sursaut de bon sens et il veut me faire payer, encore et encore.
Il ne supporte pas que j’aie osé choisir sans le consulter, sans un regard en arrière. Alors, une fois par an ou plus, il m’envoie un message en me rappelant notre incroyable histoire d’amour, il me dit qu’il est là et qu’il m’attend. Et moi quand je reçois ça, croyant l’avoir enterré, je suis prise de malaise. Vous savez, c’est comme si on me plaçait tout en haut d’un toboggan, d’un gouffre plutôt, et qu’on me poussait violemment dans le vide, prétendant ne pas m’entendre hurler de terreur. Et je tombe et tombe, je vois déjà ma mort, mais il n’y a aucune branche à laquelle me raccrocher. J’ai l’impression qu’il me dit : « Je t’aurai, tu sais, ce n’est qu’une question de temps ! »
Comme si ce n’était pas suffisant, on me demande régulièrement si je vais bientôt « me caser » et me fixer quelque part. Alors, on me dit que je suis trop difficile. C’est pourtant si facile le bonheur ! Ils ne savent rien et ils conseillent. Leur vie de couple semble plus rasoir que palpitante et ils pensent avoir la clef du bonheur. Je voudrais les faire taire en leur vomissant ma douleur ? Je tourne les talons. À quoi bon ?

……………………………………………………………………………………………………
J’ai entendu dire que si nous considérions chaque personne que nous rencontrons comme traversant de grandes épreuves, nous aurions rarement tort. Je me demande encore pourquoi certains ont le temps d’empoisonner la vie des autres par leur envie, leur bassesse, leur mauvaise langue s’ils connaissent eux-mêmes des difficultés.
Je crois que la maladie, l’abandon, la solitude, l’angoisse peuvent éveiller en l’être humain les pires comme les meilleurs instincts. J’espère qu’on aura la sagesse d’offrir à nos semblables le repos et parfois le silence au lieu de nous agiter en tous sens pour donner des conseils jugés avisés. Décidons de retenir notre langue accusatrice si adonnée aux persiflages par peur de regarder en face nos propres blessures.
Quelle intolérance de refuser aux autres le besoin si humain d’être différents, de penser différemment, de trouver des solutions différentes ! Quel aveuglement de penser savoir mieux et tout ! Admettons une bonne fois pour toutes que nous ne sommes juges que de nous-mêmes et déjà avec maladresse.
Lorsqu’on appartient à un groupe bien soudé, on se croit fort. En réalité, on devient lâche, cette part de soi qu’on ne souhaiterait jamais voir en face. Et cela commence très tôt. Les enfants rient ouvertement ou dissimulés sous un sourire convenu d’un camarade différent physiquement, mentalement ou émotionnellement. On rit d’autant plus fort de l’handicap de l’autre que cela nous fait oublier notre propre fragilité, cachée sous les épaisses couches de la convention et du qu’en dira-t-on.
Je suis révoltée contre les autres et moi-même en pensant aux fois où j’ai cédé à la peur de penser à ma façon, d’être seule dans mes convictions, de perdre la protection d’un groupe (dans lequel bien souvent je ne me reconnais pas, alors pourquoi je m’entête ?).

Si chaque jour, nous nous promettions d’être vrais avec nous-mêmes et avec les autres et d’accepter la souffrance inhérente à notre vie et à celle des autres, nous serions enfin libres et honnêtes. Peut-être alors arrêterions-nous de vivre la vie des autres et commencerions-nous à accepter la nôtre…
C’est ce que les yogis appellent « le centre ». Trouver son centre de vie, c’est accepter tout : les pensées fugaces, la lumière et les ténèbres en soi, les règles de l’existence, le passé, les peurs. Je rassemble tout et je l’expire, tel l’œil du cyclone, loin de moi, loin des autres. Il arrive alors que j’atteigne ma vérité dans le lâcher prise et que je la diffuse sur tous les fâcheux qui croisent ma route…