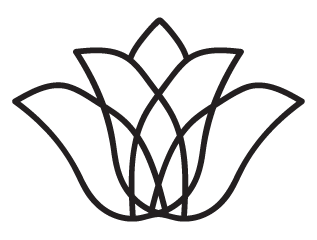« Si mon père a été si fier que j’aie publié un livre, au point de m’écrire pour m’en féliciter, c’est que j’avais sans doute accompli son rêve. J’avoue que l’écriture, ce point commun inattendu entre lui et moi, commence à fissurer ma carapace de colère et de dégoût. Comme le Monsieur Teste de Paul Valéry, mon père est l’auteur de mille histoires qu’il n’a jamais écrites que dans sa tête. À son sujet, on peut parler d’un processus constant d’invention, de réécriture de sa vie. Il a sans cesse cherché à se réfugier dans une reconstruction acceptable, vivable, du monde extérieur, et c’est en soi une activité de romancier. On se fabrique les refuges que l’on peut. Et puisque écrire, c’est habiter le monde d’une façon différente, c’est vivre à l’intérieur des histoires qu’on se raconte, je me demande ce qui distingue fondamentalement les écrivains des mythomanes. Sur son bureau, quelques stylos sont encore en bon état. Un Montblanc à pompe que j’offrirai à mon fils, en souvenir de son grand-père, un critérium et un stylo plume Parker en laiton doré, que je garderai pour moi, comme son briquet Dupont, doré lui aussi. » Vanessa Springora, Patronyme (2025)

Les années de vie ont ceci de bon qu’elles créent une réserve quasi inépuisable de rencontres, d’humains côtoyés de près ou de loin, de femmes et d’hommes croisés au cours d’un voyage en train, dans une file d’attente, de couples bruyants à la table d’à côté de la brasserie qu’on découvre pour la première fois ou de l’estaminet qu’on fréquente assidûment et dont on connaît toutes les répliques et toutes les mimiques du serveur en chef. Puis, on complète cette galerie avec les êtres qui peuplent notre quotidien, ceux qu’on croise chaque matin et qu’on salue chaque soir, celui ou celle qui partage notre vie et notre chambre à coucher et ceux avec qui on a grandi et qui demeurent parfois des énigmes à part entière.
Dans cette galerie étoffée mois après mois, on note une constante : nous sommes tous à la recherche d’un refuge, d’une espèce de paradis perdu qui nous permettrait de sauter du train, de rejoindre la berge peut-être plus sûre, de souffler un instant, de nous dilater dans un temps moins fou et qui sait, de tout recommencer en mieux ?

Pour certains, comme le père de Vanessa Springora, Patrick, le refuge tient à la quantité d’histoires inventées et narrées à autrui, histoires où il incarne toujours le héros, où il peut être aimé et admiré, où il est autre et où la vie devient alors un peu plus tenable… Pour d’autres, le refuge, c’est le père qu’on a tant aimé et admiré à en rendre jalouse la mère et qu’on a perdu prématurément, alors on revit indéfiniment les années de l’enfance, les années de complicité, les années où l’on n’était pas encore seule. Pour d’autres encore, le refuge est bâti sous l’impulsion de la colère, une colère « juste », celle qui comptabilise tout ce qu’on n’a pas eu et qu’on aurait dû avoir, celle qui est née avec persistance sous la volée des coups physiques et verbaux figeant la larme de l’enfant en perle glacée indestructible. Et l’on passe des années à peindre ce nouvel album de vie avec les parents qu’on aurait dû avoir, offrant le soutien matériel et émotionnel qui aurait permis de pousser un peu mieux et un peu plus droit et de rencontrer les bonnes personnes et de prendre les bonnes décisions. On attend, montant la garde devant ce refuge amer, que justice nous soit enfin accordée, mais en vain, alors on maudit le Créateur encore et encore et on reste en vie en remerciant la colère pour tous les coups qu’on parvient, aujourd’hui, à rendre… D’autres, enfin, soignent tout et tout le monde pour être soignés et réparés à leur tour. Dans cet hôpital de campagne, on laisse s’échapper l’odeur entêtante et saline des pleurs de l’enfance non pleurés et non consolés qu’on croit retrouver dans les grands yeux fiévreux des autres qui n’ont rien demandé et ne comptent pas restés alités jusqu’à la fin de leurs jours !
Pour moi, il est étourdissant de réussir à discerner, avec de plus en plus d’acuité, la silhouette de l’enfant dans les contours de l’adulte. Un petit être qui gémit dans la douleur depuis si longtemps, qui attend dans une cellule grise et froide sommairement travestie en salle de jeux le secours et les étreintes de l’adulte. L’enfant tape de plus en plus fort sur les parois de la solitude jusqu’à faire vriller l’adulte qui a grandi physiquement, mais pas émotionnellement. Si vous observez attentivement les êtres les plus tristes, en colère et abîmés, vous finissez par distinguer au fond de leurs grands yeux, le regard plein d’incompréhension de l’enfant. Est-il seulement possible et imaginable que deux êtres aussi éloignés dans le temps cohabitent pendant de si longues années ? Oui et aussi longtemps que l’enfant n’aura pas été consolé et guéri par la voix apaisante de l’adulte… Je parle bien sûr de l’adulte qui était enfant et pas un être extérieur à soi, pas un parent, pas une figure tutélaire du passé, mais soi-même.

C’est alors qu’on peut se raconter l’Histoire, la sienne, la vraie et faire la paix avec elle… Finies les histoires – les autres – les postures, les refuges de fortune qu’on s’est forgés toutes ces décennies pour survivre, c’est-à-dire vivre un peu moins mal. Ça semble si simple ainsi écrit et c’est pourtant si difficile d’aller trouver et réconforter l’enfant blessé qui s’est cogné la tête contre tous les bords de notre âme morcelée, celui qui nous faisait toujours réagir ainsi et toujours avec la même impulsivité et irréflexion, celui qui criait et pleurait en nous dérobant notre énergie vitale, celui qui rompait sans cesse avec les autres et larguait les amarres avant de le regretter amèrement, celui qui nous ramenait sans cesse au même mur infranchissable de solitude et de silence.
Je crois l’avoir déjà écrit, mais ma grand-mère est décédée il y a un an exactement.
Elle et sa maison où j’ai passé tant de vacances au cours de mon enfance étaient mon refuge.
La maison a été vendue après le décès de son mari, Robert, mon grand-père et Raymonde, ma grand-mère, est venue vivre tout à côté de mes parents. Elle a pleuré secrètement les mois qui ont suivi ce changement de vie à un âge déjà avancé, car elle n’avait plus sa maison, son refuge et le mien. Une plaie du passé se réouvrait : tout comme elle avait perdu sa maison du Tréport bien des décennies plus tôt pour partir à l’autre bout du monde sur un petit caillou sans impôts, elle avait perdu sa maison du Loir et Cher, la dernière sur la route du Poirier Pigeon… Sa maison de la route du Poirier Pigeon, un petit segment bleu sur Google Maps ou encore la tache aveugle sur la grande carte de la France, elle en était l’âme et la propriétaire exemplaire. Elle y avait accroché et rangé les quelques brides de son passé – un passé de grande voyageuse qui la distinguait tant du reste de sa fratrie picarde – des souvenirs du Pacifique, de l’Afrique, du Canada et c’était déjà beaucoup pour la petite fille qui avait, jadis, arpenté en galoches les champs ingrats d’Hargicourt et enfoncé ses mains dans la terre grasse et rude de la Somme.
Raymonde, elle avait un cœur aussi grand et généreux que les énormes framboises qu’elle cueillait, bichonnait et récoltait chaque été pour les transformer en confitures et coulis. Il n’y a pas à dire, elle était faite pour être grand-mère et elle sentait toujours bon la généreuse cuisine à base de crème fraîche et d’amour à laquelle elle se livrait matin et soir en prenant garde d’ouvrir grand les fenêtres donnant sur son paradis de roses rouges. Peu de voitures passaient devant la maison sans portail et les étés y étaient très doux et très très simples.

Pourquoi est-ce que je retourne sans cesse dans cette maison au bout de la route du Poirier Pigeon ?
Je rêve souvent que j’entrouvre la porte d’entrée ou celle de la cuisine pour la retrouver avec sa voix forte, rassurante et pleine d’accents joyeux, je rêve tout simplement que je la retrouve… Mon enfant intérieur avec qui j’ai pourtant beaucoup communiqué ces dernières années et que j’ai réconforté à plusieurs reprises et conduit dans les champs de marguerites ne trouve nulle consolation et s’accroche à ce refuge caché sur le petit segment bleu indiqué par Google Maps. Il arrive qu’à mon réveil et ayant à nouveau perdu Raymonde ma tristesse soit infinie et le vide étourdissant sous mes pieds et haletant dans ma poitrine.
Je sais, pourtant, qu’il faudra bien avancer et quitter la maison de mon enfance sans la vouer à l’oubli.
Je me dis alors qu’écrire sur elle pourrait bien être l’unique moyen d’habiter une fois encore sa maison, la dernière de la route du Poirier Pigeon, vivre quelques temps à l’intérieur des histoires qu’elle m’a racontées encore et encore et qu’on a tous fini par se raconter sans en connaître ni le début, ni la fin, ni les détails, ni les transitions. Raconter son histoire et la nôtre, l’histoire des femmes qui l’ont suivie, autant de vies minuscules gagnées par les non-dits, les répétitions et les silences lourds de sens. Raconter cette histoire pourrait être la clé de toutes les autres et écrire pourrait-il alors guérir elle, elles – ses descendantes – et moi-même ?