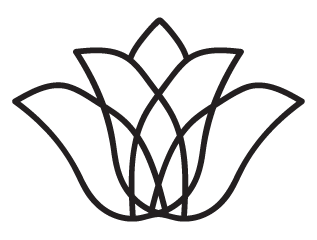« The shade of the fine trees raise a kind of Awe in the mind, and as time gives a kind of Respect and [H]exaltation even to inanimate things, one looks upon these noble Oaks with a sort of Superstitious awe, & as time changes circumstances, they who had once their idle & superfluous excrescences cut with a golden Instrument are now without mercy mark’d for the Rude & fatal ax: and from being the Altars of the Druids are destined to be Ships of War & to deal those mischief they once were supplicated to avert. » Lettre d’Elizabeth Montagu à Mary Anstey (3 décembre 1747, EMCO 702)

J’ai été saisie par ces mots en parcourant la correspondance d’Elizabeth Montagu. Les chênes agitant feuilles, branches et ombres au-dessus des mortels en quête de rêverie, d’émerveillement, dirons-nous de « divin », me faisaient penser à ces vies disparues et à ce qu’il en reste. Au cœur de son froid hiver anglais, un 3 décembre, Montagu avait écrit sur la fragilité de l’existence et sur la mélancolie profonde qui l’accompagne.
Il lui suffisait de passer ses doigts le long de l’écorce rugueuse pour sentir les décennies de vies qui s’y cachaient et la folie des hommes à l’œuvre. Comment avions-nous pu bénir ces immenses chênes et en faire des lieux de culte au temps des druides pour ensuite les entailler, les percer de part en part pour en faire des coques de navires de guerre ? Pourquoi n’avions-nous rien entendu, rien retenu de ce qu’ils essayaient de nous dire depuis les origines du monde ? Les chênes étaient conçus pour nous bercer par le constant froissement des feuilles les unes contre les autres, poussées par le vent chahuteur ; ils étaient créés pour accorder ombre et fraîcheur contre le soleil brûlant ; ils étaient la preuve qu’on ne peut vivre sans racines ni rameaux et on en avait fait le véhicule de la conquête.

Nous avons tous connu d’autres chênes, ces humains immenses et nobles de cœur qui nous donnent le secours de leurs bras, le chant de leur voix et un lieu de repos où s’arrêter un peu pour contempler la vie et la comprendre. Il arrive que ces chênes disparaissent après des décennies de lutte et on ne trouve plus ni ombre, ni bruissement, ni paix. On est, pour ainsi dire, orphelins et la perte nous serre la gorge au creux d’une nuit de larmes. On ne peut pas en parler car on vous répète que c’est le cycle de la vie, que la vieillesse était un tel fardeau pour cet être cher que la mort est venue telle une délivrance, qu’enfin vous la retrouverez après cette vie…
Et vous restez seule avec la gorge serrée et les larmes chaudes et pesantes.
Puis, toutes les réactions des proches se bousculent. Le chêne fait pour le culte druidique et la religion du cœur est utilisé pour alimenter les querelles intestines. Ils pleurent aussi j’imagine, mais le deuil se transforme en désir effréné de récupérer les quelques objets qui constituaient l’univers de la disparue. Le bois fendille et on creuse une coque de navire de guerre ou de navire marchand dans l’écorce encore tiède…
Je me rappelle avoir négligemment tiré un des tiroirs du meuble de salle de bain et saisi la brosse à cheveux de ma chère grand-mère : ses cheveux blancs et fatigués étaient encore accrochés aux picots, une lime marquait le chemin où ses ongles étaient passés et j’ai cru, un instant, en repoussant doucement le tiroir que si je fermais les yeux et respirais profondément, je finirais par entendre son souffle lourd dans le salon, sa respiration de vieille femme, et peut-être son rire frais et aigu d’antan. Mais non, seul le silence pesait sur mon cœur et sur les lieux. Ce n’étaient que des objets inanimés et sans âme en l’absence de celle qui les maniait. Alors j’ai tout laissé et fui dans mes larmes.
Je tente en vain dans de nombreux rêves de retrouver la sécurité de mon chêne, mais au réveil, il s’en est allé, et je sens la perte et le fuite du temps comme je les sentais déjà très jeune jusqu’à en avoir le souffle coupé.
Ce que je me dis, et c’est cela que je voudrais dire, c’est que si je vis selon la vérité de mon cœur, comme elle, si je suis une femme heureuse autant qu’elle le voudrait et peut-être plus qu’elle ne l’a été, alors elle continuera de vivre en moi et avec moi, alors elle bénira mes jours en m’offrant un abri et une ombre plus immenses que ceux produits de son vivant, alors nos deux mondes convergeront au-delà des objets, des lieux, des livres échangés, des films regardés à deux avec un esquimau dans la main droite, des parties de petits chevaux interminables et devenues « rituelles », des mots griffonnés encore et encore et nous rirons ensemble dans le bruissement des larges feuilles du chêne portées par un vent doux et frais…
Alors la mort ne sera plus…
LISE